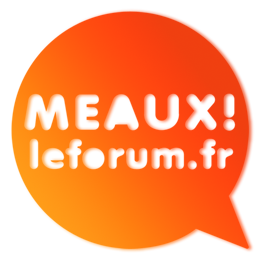Meaux : Un jour dans la tour Anjou (article du Parisien)
Meaux : Un jour dans la tour Anjou (article du Parisien)
Dim 29 Nov 2009, 21:47
Un post pour réagir à l'article-témoignage paru sur Le Parisien :
MEAUX : un jour dans la tour d’Anjou
par Emeline Cazi (le 29/11/2009)
Elles sont visibles de loin en arrivant par la nationale 3. Ces tours en forme d’étoile à trois branches sont emblématiques de Beauval, l’un des deux quartiers sensibles de Meaux , en Seine-et-Marne (avec celui de la Pierre-Collinet). Dans la tour d’Anjou, 169 familles se croisent chaque jour. Petites histoires de vie de ces habitants ordinaires de la banlieue.
Les travailleurs de l’aube
A 5 heures, tous les matins, Myriam descend 15 étages à pied pour aller travailler. A 10 h 15, lorsqu’elle rentre, elle remonte encore à pied. Myriam ne prend plus l’ascenseur depuis qu’elle a failli y rester coincée avec sa fille. Dix ans qu’elle nettoie le Quick de la nationale 3, six jours par semaine. Elle rentre chez elle, elle dort. Elle attend sa fille pour déjeuner puis passe l’après-midi devant la télé. Le lundi, son seul jour de repos, c’est jour de ménage à la maison. « J’aime bien ma vie ici. J’ai 40 ans, je dois travailler. Y a pas de boulot ailleurs, surtout quand t’es noire. »
Martial, maçon, père de deux enfants, part aux aurores lui aussi, mais avec ses cannes à pêche. « Je fais les intérims, il n’y a pas grand-chose en ce moment. On vit comme on peut, on se débrouille. Je trouve des anguilles et des barbillons en bord de Marne. »
Vers 7-8 heures, les pères de Rania, Coralie et Sarah, trois copines de collège, se dirigent vers la zone industrielle, derrière le centre commercial, où se trouve l’entreprise Frisquet, fabricant de chaudières. Ourra, 35 ans, attend le bus pour la gare. « On vit ici par contrainte, parce qu’on ne peut pas trouver mieux ailleurs. J’ai deux heures de train par jour, le week-end, je me repose. Ma seule distraction, c’est d’aller faire les courses au centre commercial. »
Les jeunes des boîtes aux lettres
Les jeunes se comportent à Beauval comme ailleurs. Ils se retrouvent là où ils peuvent. Le plus souvent devant les boîtes aux lettres de la tour. Adama est magasinier à Disney. Malick travaille dans la restauration. Il se rêvait ambulancier. « J’ai cherché une formation, mais le temps est passé… » Moussa a arrêté les cours en 3 e . « J’ai travaillé dans des usines de béton à Cergy (Val-d’Oise) », dit-il. Aujourd’hui, il envoie des CV sans grand succès. « Quand on est là, c’est mal vu. Les gens pensent qu’il y a du trafic ». Moussa assure qu’ils ne font rien d’autre que discuter. « Les gens, on les respecte, on nous l’a appris. »Il y a quand même Myriam, au 15 e , qui peste contre ceux « qui se droguent toute la nuit derrière sa porte », et puis tous les habitants dont les fenêtres donnent sur le parking qui redoutent les interminables barbecues des nuits d’été…
Les jeunes répondent qu’ils n’ont nulle part où se retrouver pour draguer, fumer, se défouler. « On avait un terrain de foot, ils nous l’ont retiré parce qu’on faisait trop de bruit, déplore Moussa. Alors on joue ici, devant l’immeuble. » Au fil de la discussion, Adama admet que « quand on habitait Collinet (NDLR : l’autre quartier sensible de la ville) , on oscillait entre délinquance et honnêteté. On a volé des voitures à 14 ans, mais jamais pire que ça… » Malick travaille depuis qu’il a 22 ans. « Nous, on a pris le bon chemin, dit-il. On a des copains qui ont mal fini et qui ont pris dix ans pour trafic. » 16 h 35, l’heure de pointe aux ascenseurs Les couloirs de l’immeuble sont plutôt calmes l’après-midi. Une femme efface des traces de roues de vélo laissées sur le sol. Nataf, 35 ans, quatre enfants, un mari commis de cuisine à La Défense, couche le petit dernier et en profite pour faire un brin de ménage. Un moment de répit avant la tornade de 16 h 30, l’heure où les enfants sortent en courant de l’école, traversent l’impasse et s’engouffrent dans le hall.
A 16 h 35, c’est l’heure de pointe aux ascenseurs.
Ils sont quatre derrière la poussette de Marie-Dominique. Comme toutes les mamans, elle vit au rythme des enfants. A elle de les préparer le matin, de les récupérer à 11 h 30. A midi, c’est la course.
Elle fait au plus simple, dépose un plat de Knacki et des crèmes dessert sur la table basse. Les inscrire à la cantine coûterait trop cher : « Pour avoir les aides, il faut toucher le smic. » Le soir, c’est encore la course. Il n’y a guère que Lydia qui trouve le temps de lire et de participer aux ateliers du centre Louis-Aragon. Son fils, Jean-Daniel, 7 ans, sera « conducteur de TGV ». Un jour elle écrira son histoire. Celle d’une cadre au Congo, employée à la direction d’une compagnie aérienne, obligée de quitter le pays avec un nourrisson. Sans papiers en France, elle est logée par une association dans un coquet deux-pièces et attend de « pouvoir faire grandir son fils dans un endroit plus calme ».
L’isolement par peur des commérages
On imagine, à tort, que les liens se créent facilement entre voisins d’un tel immeuble. L’histoire de la famille de Coralie, hébergée depuis septembre par des amis, et qui cohabite joyeusement à douze dans un F4, reste une exception. A Anjou, les gens préfèrent limiter les contacts « par peur des commérages ». Sandrine, arrivée il y a huit ans d’un village de l’Yonne, ne s’est jamais intégrée. Ses filles non plus. Au collège Camus, elles ont été exclues par les autres élèves. Sophia, 14 ans, ne va plus en cours depuis un an : la rumeur court qu’elle est enceinte.
Christian, le locataire du 3 e , passe ses journées seul. « Je fais un peu de sport, je sors pour les courses, mais je ne vois personne », reconnaît ce professeur. Des soucis de santé l’ont obligé à arrêter d’enseigner il y a dix ans. Sa femme est partie, ses amis se sont éloignés.
Dans son studio dont il ferme la porte à double tour, le lit et l’ordinateur constituent l’essentiel de l’ameublement. « Je passe facilement quatre à huit heures par jour sur Internet. Je travaille un peu mon anglais, je fais des maths. »
Même étage, couloir B, Martine et Farid dépriment. On les trouve en pyjama à midi, devant une tasse de café, fumant cigarette sur cigarette. Lui a grandi à la Ddass. Elle n’a pas vu sa fille depuis six ans. « Tous les jours se ressemblent. L’après-midi, on va promener Cyrius au bord du Canal. Le chien est important pour nous, si on ne l’avait pas, on s’ennuierait », confie-t-elle. « Cela fait douze ans qu’on est là. Il faut qu’on déménage parce que je ne supporte plus. Je n’ai pas rencontré une seule femme avec qui j’ai pu discuter ». Ils projettent de rejoindre la soeur de Martine à Rouen, mais pas avant mars, « le temps de faire quelques économies. On gagne 630 € chacun. On est raides, il faut se priver tout le temps ».
CLÉS
Meaux est une ville de 50 000 habitants, située à 50 km à l’est de Paris.
La résidence compte 16 étages. Au centre, deux ascenseurs desservent les 3e, 7e, 11e et 15e. Les niveaux intermédiaires sont desservis par des escaliers.
MEAUX : un jour dans la tour d’Anjou
par Emeline Cazi (le 29/11/2009)
Elles sont visibles de loin en arrivant par la nationale 3. Ces tours en forme d’étoile à trois branches sont emblématiques de Beauval, l’un des deux quartiers sensibles de Meaux , en Seine-et-Marne (avec celui de la Pierre-Collinet). Dans la tour d’Anjou, 169 familles se croisent chaque jour. Petites histoires de vie de ces habitants ordinaires de la banlieue.
Les travailleurs de l’aube
A 5 heures, tous les matins, Myriam descend 15 étages à pied pour aller travailler. A 10 h 15, lorsqu’elle rentre, elle remonte encore à pied. Myriam ne prend plus l’ascenseur depuis qu’elle a failli y rester coincée avec sa fille. Dix ans qu’elle nettoie le Quick de la nationale 3, six jours par semaine. Elle rentre chez elle, elle dort. Elle attend sa fille pour déjeuner puis passe l’après-midi devant la télé. Le lundi, son seul jour de repos, c’est jour de ménage à la maison. « J’aime bien ma vie ici. J’ai 40 ans, je dois travailler. Y a pas de boulot ailleurs, surtout quand t’es noire. »
Martial, maçon, père de deux enfants, part aux aurores lui aussi, mais avec ses cannes à pêche. « Je fais les intérims, il n’y a pas grand-chose en ce moment. On vit comme on peut, on se débrouille. Je trouve des anguilles et des barbillons en bord de Marne. »
Vers 7-8 heures, les pères de Rania, Coralie et Sarah, trois copines de collège, se dirigent vers la zone industrielle, derrière le centre commercial, où se trouve l’entreprise Frisquet, fabricant de chaudières. Ourra, 35 ans, attend le bus pour la gare. « On vit ici par contrainte, parce qu’on ne peut pas trouver mieux ailleurs. J’ai deux heures de train par jour, le week-end, je me repose. Ma seule distraction, c’est d’aller faire les courses au centre commercial. »
Les jeunes des boîtes aux lettres
Les jeunes se comportent à Beauval comme ailleurs. Ils se retrouvent là où ils peuvent. Le plus souvent devant les boîtes aux lettres de la tour. Adama est magasinier à Disney. Malick travaille dans la restauration. Il se rêvait ambulancier. « J’ai cherché une formation, mais le temps est passé… » Moussa a arrêté les cours en 3 e . « J’ai travaillé dans des usines de béton à Cergy (Val-d’Oise) », dit-il. Aujourd’hui, il envoie des CV sans grand succès. « Quand on est là, c’est mal vu. Les gens pensent qu’il y a du trafic ». Moussa assure qu’ils ne font rien d’autre que discuter. « Les gens, on les respecte, on nous l’a appris. »Il y a quand même Myriam, au 15 e , qui peste contre ceux « qui se droguent toute la nuit derrière sa porte », et puis tous les habitants dont les fenêtres donnent sur le parking qui redoutent les interminables barbecues des nuits d’été…
Les jeunes répondent qu’ils n’ont nulle part où se retrouver pour draguer, fumer, se défouler. « On avait un terrain de foot, ils nous l’ont retiré parce qu’on faisait trop de bruit, déplore Moussa. Alors on joue ici, devant l’immeuble. » Au fil de la discussion, Adama admet que « quand on habitait Collinet (NDLR : l’autre quartier sensible de la ville) , on oscillait entre délinquance et honnêteté. On a volé des voitures à 14 ans, mais jamais pire que ça… » Malick travaille depuis qu’il a 22 ans. « Nous, on a pris le bon chemin, dit-il. On a des copains qui ont mal fini et qui ont pris dix ans pour trafic. » 16 h 35, l’heure de pointe aux ascenseurs Les couloirs de l’immeuble sont plutôt calmes l’après-midi. Une femme efface des traces de roues de vélo laissées sur le sol. Nataf, 35 ans, quatre enfants, un mari commis de cuisine à La Défense, couche le petit dernier et en profite pour faire un brin de ménage. Un moment de répit avant la tornade de 16 h 30, l’heure où les enfants sortent en courant de l’école, traversent l’impasse et s’engouffrent dans le hall.
A 16 h 35, c’est l’heure de pointe aux ascenseurs.
Ils sont quatre derrière la poussette de Marie-Dominique. Comme toutes les mamans, elle vit au rythme des enfants. A elle de les préparer le matin, de les récupérer à 11 h 30. A midi, c’est la course.
Elle fait au plus simple, dépose un plat de Knacki et des crèmes dessert sur la table basse. Les inscrire à la cantine coûterait trop cher : « Pour avoir les aides, il faut toucher le smic. » Le soir, c’est encore la course. Il n’y a guère que Lydia qui trouve le temps de lire et de participer aux ateliers du centre Louis-Aragon. Son fils, Jean-Daniel, 7 ans, sera « conducteur de TGV ». Un jour elle écrira son histoire. Celle d’une cadre au Congo, employée à la direction d’une compagnie aérienne, obligée de quitter le pays avec un nourrisson. Sans papiers en France, elle est logée par une association dans un coquet deux-pièces et attend de « pouvoir faire grandir son fils dans un endroit plus calme ».
L’isolement par peur des commérages
On imagine, à tort, que les liens se créent facilement entre voisins d’un tel immeuble. L’histoire de la famille de Coralie, hébergée depuis septembre par des amis, et qui cohabite joyeusement à douze dans un F4, reste une exception. A Anjou, les gens préfèrent limiter les contacts « par peur des commérages ». Sandrine, arrivée il y a huit ans d’un village de l’Yonne, ne s’est jamais intégrée. Ses filles non plus. Au collège Camus, elles ont été exclues par les autres élèves. Sophia, 14 ans, ne va plus en cours depuis un an : la rumeur court qu’elle est enceinte.
Christian, le locataire du 3 e , passe ses journées seul. « Je fais un peu de sport, je sors pour les courses, mais je ne vois personne », reconnaît ce professeur. Des soucis de santé l’ont obligé à arrêter d’enseigner il y a dix ans. Sa femme est partie, ses amis se sont éloignés.
Dans son studio dont il ferme la porte à double tour, le lit et l’ordinateur constituent l’essentiel de l’ameublement. « Je passe facilement quatre à huit heures par jour sur Internet. Je travaille un peu mon anglais, je fais des maths. »
Même étage, couloir B, Martine et Farid dépriment. On les trouve en pyjama à midi, devant une tasse de café, fumant cigarette sur cigarette. Lui a grandi à la Ddass. Elle n’a pas vu sa fille depuis six ans. « Tous les jours se ressemblent. L’après-midi, on va promener Cyrius au bord du Canal. Le chien est important pour nous, si on ne l’avait pas, on s’ennuierait », confie-t-elle. « Cela fait douze ans qu’on est là. Il faut qu’on déménage parce que je ne supporte plus. Je n’ai pas rencontré une seule femme avec qui j’ai pu discuter ». Ils projettent de rejoindre la soeur de Martine à Rouen, mais pas avant mars, « le temps de faire quelques économies. On gagne 630 € chacun. On est raides, il faut se priver tout le temps ».
CLÉS
Meaux est une ville de 50 000 habitants, située à 50 km à l’est de Paris.
La résidence compte 16 étages. Au centre, deux ascenseurs desservent les 3e, 7e, 11e et 15e. Les niveaux intermédiaires sont desservis par des escaliers.
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum